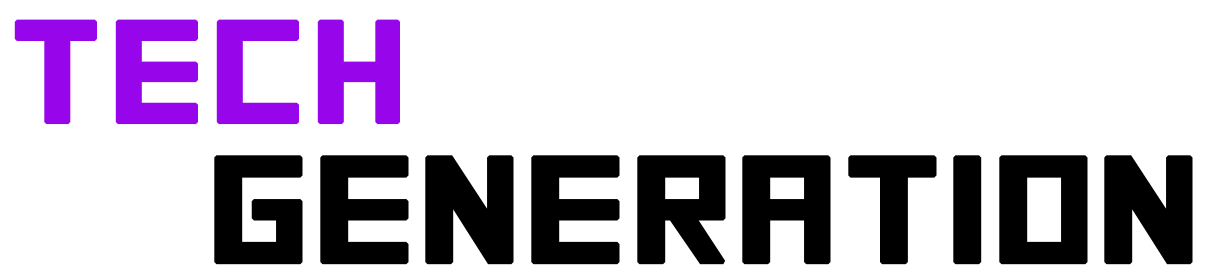Cher lecteur sous perfusion permanente de tech, respirons un grand coup de miasmes numériques : de la solitude sponsorisée dans le métro new-yorkais (Friend), à la tentacule verte de Nvidia qui investit plus vite qu’une crypto-monnaie s’évapore, en passant par les « valeurs » variables d’OpenAI et les aéroports européens otages d’un ransomware digne du Futuroscope (Catch Me If You Scan). Ce monde se rêve hyperconnecté mais s’offre toujours plus vulnérable, supervisé, privatisé, surveillé… jusqu’à la paranoïa neuro-numérique. Quel est donc le point de bascule entre progrès et asphyxie technologique ?
Commençons par cette délicieuse ironie commerciale : la startup Friend croit réinventer l’amitié via un badge connecté aussi minimaliste qu’invasif, collé entre deux publicités vides et une batterie de 129 dollars. Sous prétexte de créer du lien, voilà la solitude algorithmisée, la chaleur humaine suppléée par un « compagnon » qui vous écoute (et vous revend) vos pensées dans la rame bondée. Un miroir de notre époque anxieuse de se parler, mais accro aux notifications et autres vibrations fantomatiques proposées par la « tech for good », enfin tant qu’il reste du crédit (et de la bonne foi).
En parallèle, Nvidia resserre la nasse. Le champion californien de l’IA, dans une frénésie d’investissements tous azimuts, infiltre la moindre startup exponentielle, nouant chaque nœud de silicium à sa propre stratégie prédatrice. À mesure qu’il finance OpenAI, xAI, Mistral ou le moindre obscur labo qui rêve de transformer la science humaine en montagne de zéros binaires, Nvidia pose un verrou matériel sur la créativité mondiale. L’innovation ? Oui, mais si elle tourne sur carte Nvidia, s’il vous plaît. Même le « club du milliard » ne bouge plus qu’à coups de driver propriétaire et d’abonnement à vie.
L’innovation technologique d’aujourd’hui, c’est l’exposition de notre intimité et la privatisation de nos vulnérabilités, emballées dans une rhétorique de progrès collectif.
Le clou du spectacle se plante chez OpenAI : championne autoproclamée de l’intérêt général, elle peaufine surtout ses vernis de vertu sous la houlette d’un spin doctor recyclé de la politique et Airbnb. Contentieux multiples, exploitation énergétique de villes oubliées, deepfakes nécrophiles à la Sora et mœurs juridiques de voyou : la tech du bien commun semble run par le cynisme, dopée à la logorrhée de « fair use » et aux procès intimidants contre ceux qui, bizarrement, résistent encore à l’annexion. L’humain y devient variable d’ajustement tandis que l’empathie s’écoute en bande passante, et l’éthique se négocie à la marge du copyright. D’ailleurs, qui s’étonnera que nos aéroports européens, où tout est désormais système partagé, soient les nouvelles victimes d’un ransomware – fragile maillage où une attaque sur un prestataire suffit à saper la mobilité de centaines de milliers de passagers ? Nous partageons tout, surtout nos failles, nos files d’attente et nos clés USB vérolées.
À force de déléguer nos relations, nos rêves, notre créativité et même notre ponctualité à la technosphère, nous voilà fidèles à la doctrine de l’efficience… jusqu’à ce qu’un badge d’amitié, une pénurie de GPU, une clause absurde de « fair use » ou une cyberattaque fassent dérailler la machine. La société de la « connexion perpétuelle » craque précisément là où elle prétend exceller, dans la capacité à collecter, contrôler et générer – amis, données, contenus ou mouvements de masse. Au final, qu’est-ce qui reste de notre désir d’autonomie, sinon le choix du badge à la boutonnière, du cloud pour pleurer ou de la file d’attente pour méditer entre deux crashs systèmes ?